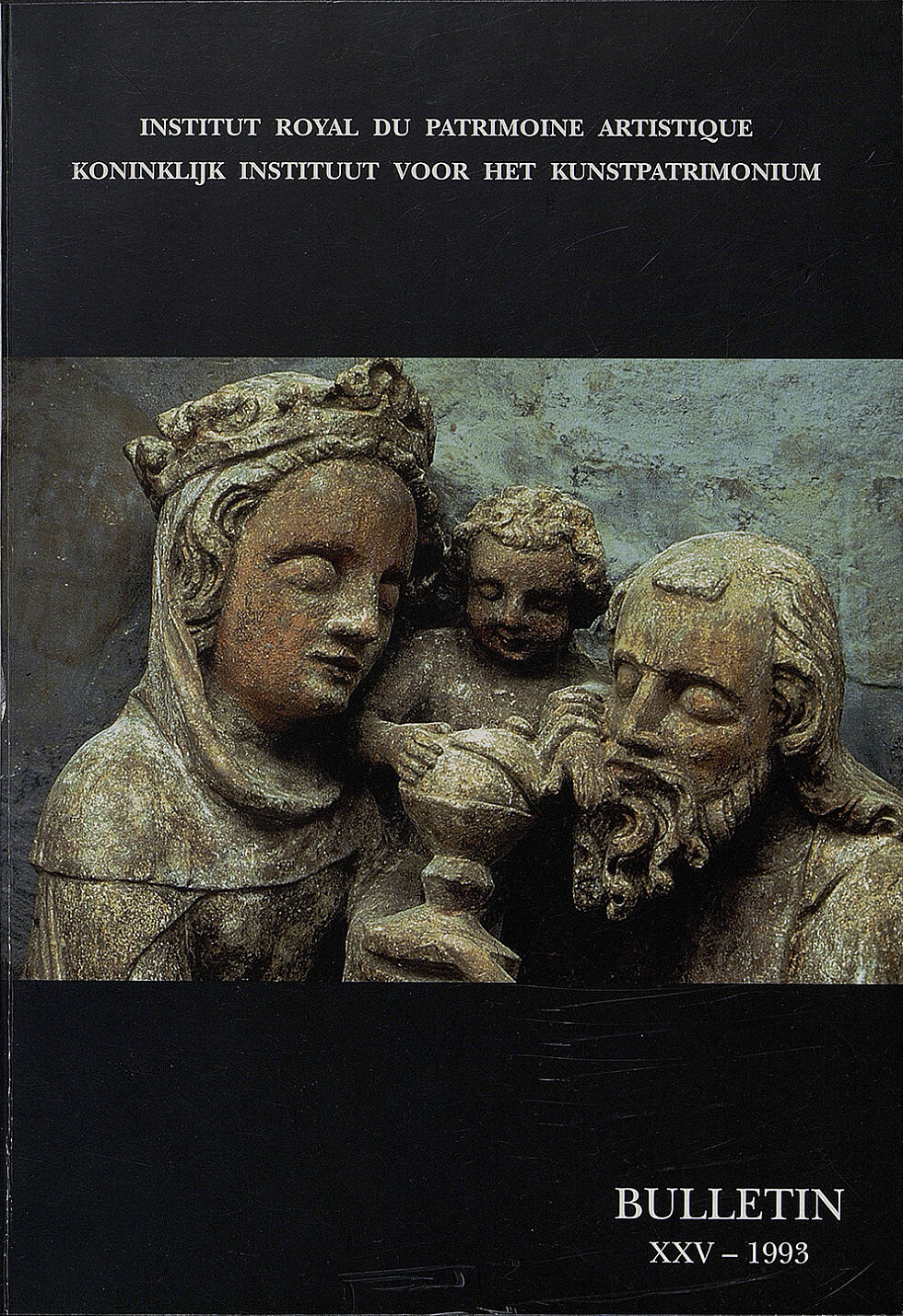Il
n’est pas rare que soient aujourd’hui remises en question les notions de
sécularisation et de décontextualisation des œuvres d’art qui ont présidé à la
création, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, des musées
modernes. D’où le risque de vouloir réécrire notre passé en reconsidérant les
transferts patrimoniaux qui ont, de tous temps, jalonné l’histoire. Le cas sans
doute le plus révélateur est celui des saisies révolutionnaires françaises, à
une époque cruciale pour l’éveil de la conscience patrimoniale. Aujourd’hui
encore, les passions restent vives en certaines contrées jadis dépouillées de
nombreux chefs-d’œuvre. Poser la question de ces transferts de patrimoine à la
fin du XVIIIe siècle sous le seul angle des spoliations apparaîtrait
toutefois réducteur, car ce serait oublier combien l’appropriation des œuvres
culturelles par la nation française procédait alors d’une ambition universelle
de libération et de promotion de l’art aux fins d’éducation de tous les
citoyens.
Issues d’un colloque organisé par l’IRPA dans la foulée de son inventaire scientifique des peintures et des sculptures saisies par les révolutionnaires français dans les Pays-Bas autrichiens et la principauté épiscopale de Liège, les contributions proposées réévaluent à leur manière les circonstances historiques, politiques et culturelles des prélèvements d’œuvres d’art, d’archives et de bibliothèques dans divers pays d’Europe, ainsi que leurs répercussions.
D'autres publications de l'IRPA